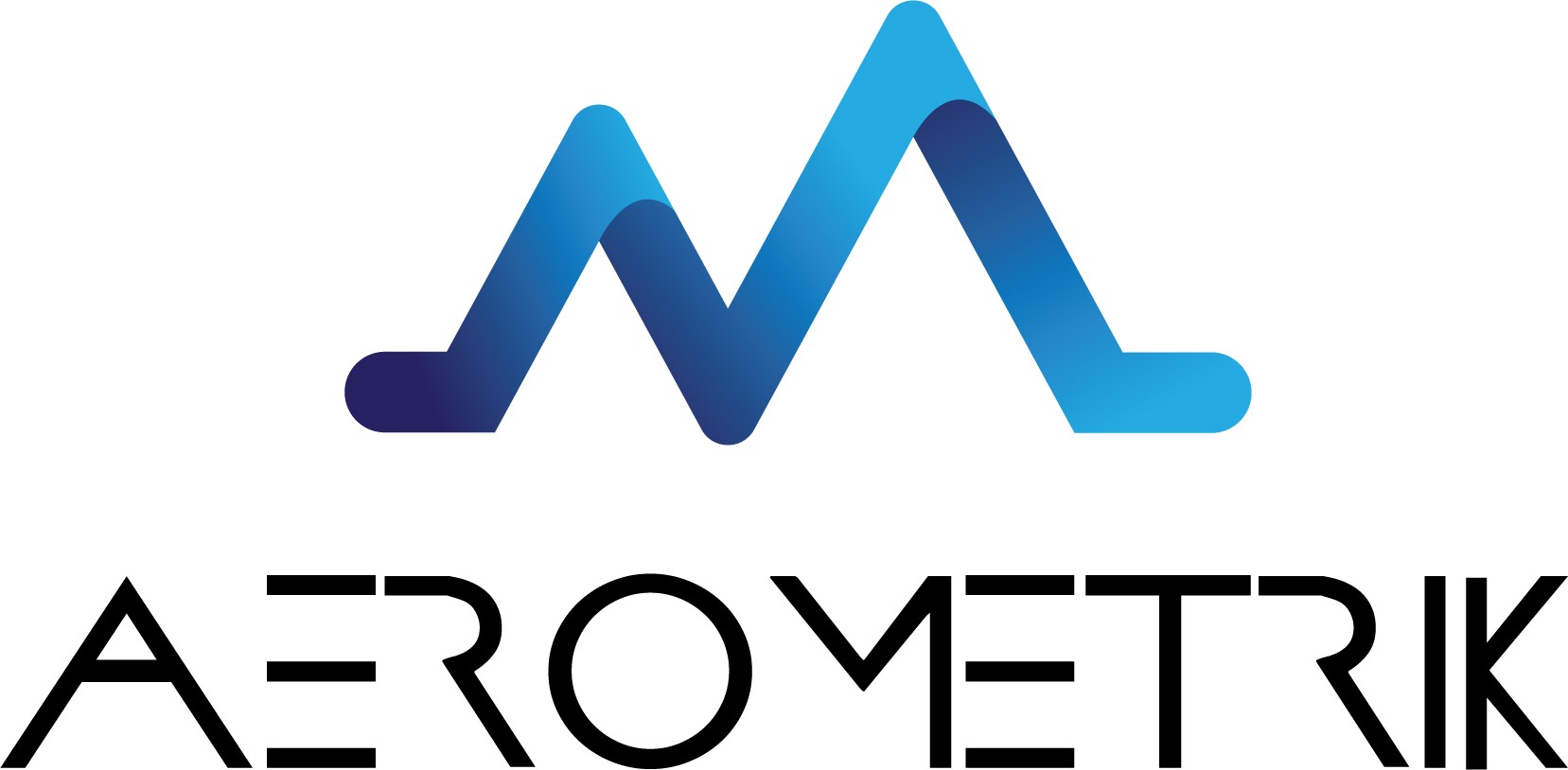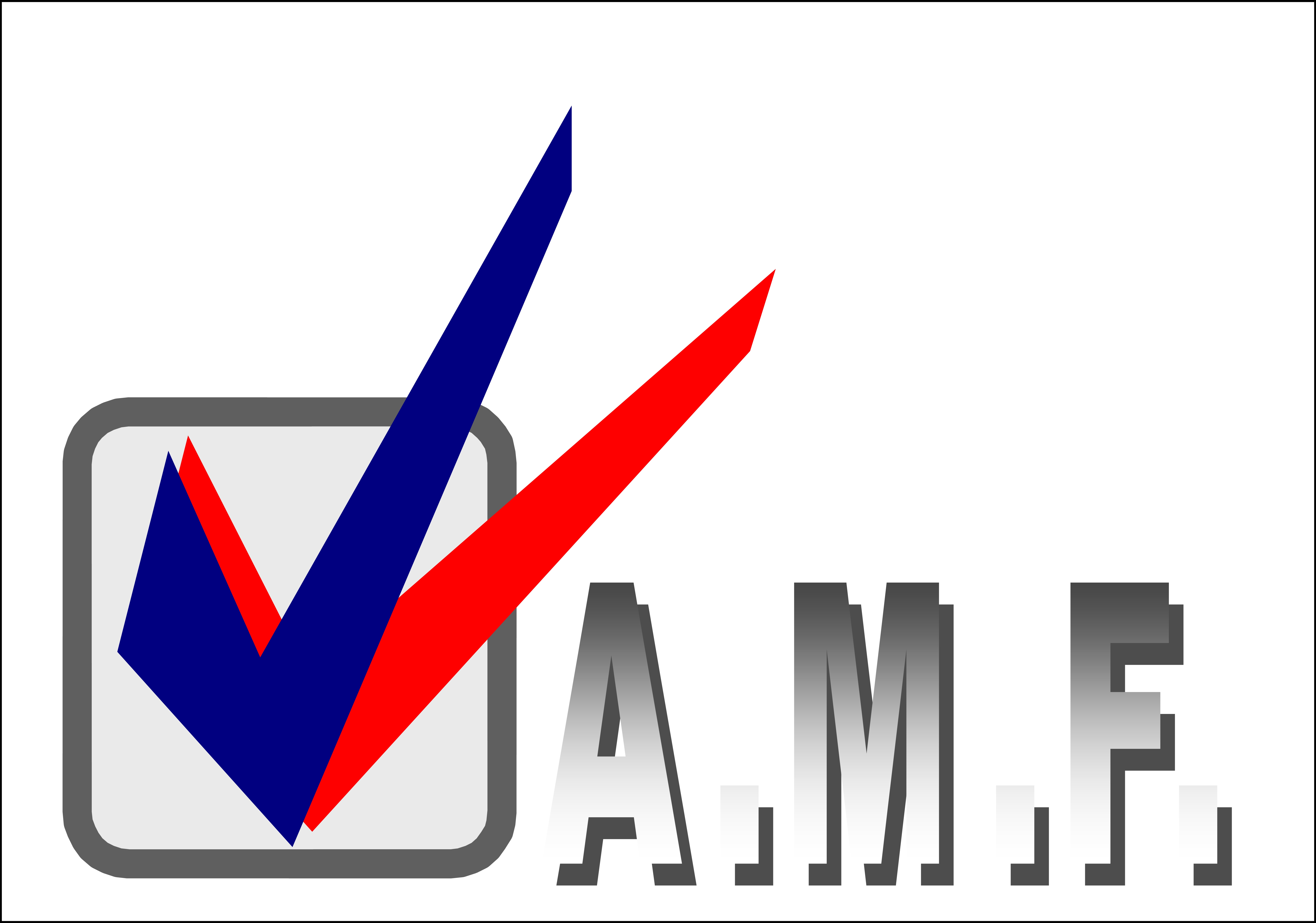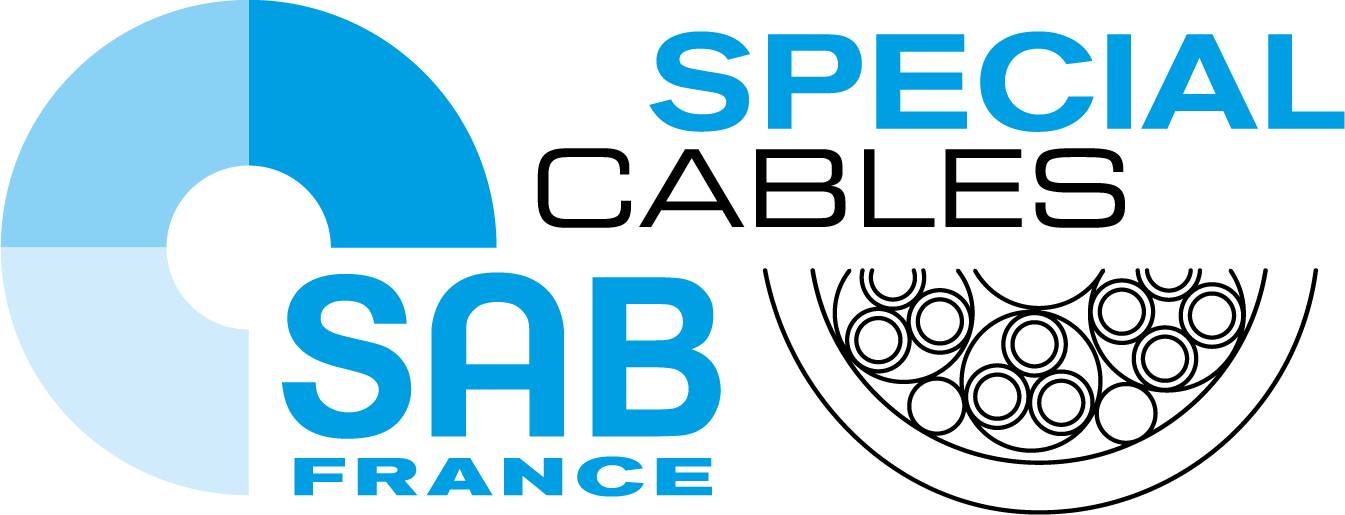Medtech en Allemagne : une reprise timide cette année ?
Coûts, réglementation, risques géopolitiques : la technologie médicale est sous pression en Allemagne. Dans le même temps, développement durable, IA et cybersécurité exigent des réponses rapides. Le sous-traitant en électronique (EMS) Plexus analyse ici les défis auxquels les fabricants de DM allemands sont confrontés.
Le marché de la technologie médicale en Allemagne a été marqué, en 2024, par des niveaux de stocks élevés hérités de la période post-pandémie. De nombreux projets ont pris du retard, ce qui a freiné la prise de nouvelles commandes. Selon l’association industrielle Spectaris, le secteur a clôturé l’année 2024 avec une croissance limitée à 2,5 % pour atteindre un CA de 41,4 M€ . Mais une lueur d’espoir est apparue dès le début de 2025, avec une progression de 3,4 % enregistrée au premier trimestre, par rapport au premier trimestre 2024.
La hausse des coûts, les contraintes bureaucratiques et un blocage des investissements dans le secteur de la santé continuent toutefois de freiner les attentes d’un retour rapide à une croissance fiable. Alors que le marché national ne redémarre que lentement, c’est surtout l’activité internationale qui soutient la croissance. Ainsi, le taux d’exportation est resté stable à 68 % en 2024. Mais cette dépendance internationale doit être abordée avec prudence compte tenu des incertitudes géopolitiques et des conflits commerciaux.
La Medtech, entre droits de douane et relocalisation
Le commerce international met en effet de plus en plus la Medtech allemande sous pression. De nouveaux droits de douanes et des exigences de "contenu local" (local content) – notamment aux États-Unis mais aussi dans la région EMEA – compliquent l’accès à des marchés clés. Cette évolution oblige les fabricants à repenser la base de leurs chaînes d’approvisionnement et leurs stratégies de production. La relocalisation (re-shoring) et les chaînes d’approvisionnement régionales doivent réduire le risque géopolitique.
En pratique, la relocalisation de la production est toutefois très risquée, du moins en ce qui concerne la création de nouveaux sites et capacités de production. Elle engloutit énormément de temps de gestion, de dépenses d’investissement et de liquidités. Elle mobilise des ressources financières et humaines qui devraient en réalité être investies dans le développement technologique et l’acquisition de clients. De plus, il est difficile de prévoir l’évolution du bras de fer commercial, toujours d'actualité. Ainsi, une production locale aux États-Unis n’est par exemple pas une option prioritaire pour les fabricants de dispositifs médicaux, selon une enquête menée par l’Institut Johner avec le BVMed.
À la place, la résilience des entreprises passe au premier plan. Les sociétés doivent libérer et réallouer de manière flexible leurs moyens financiers et humains afin de renforcer les moteurs de croissance. Un levier central est l’externalisation ciblée de tâches complexes. Les partenaires EMS (Electronic Manufacturing Services) offrent ici une alternative dynamique et peu capitalistique à la création de capacités propres. Ils permettent aux fabricants de mettre plus rapidement de nouvelles technologies et produits sur le marché, de développer leurs relations clients tout en réduisant risques, coûts et engagements.
Une réglementation qui freine la croissance
Un autre facteur difficile à prévoir en 2026 reste l’agenda réglementaire de l’UE. Des appels à une révision du règlement européen sur les dispositifs médicaux (MDR) se répètent depuis des années. L'an dernier, le Parlement européen a d'ailleurs pressé la Commission de présenter des propositions. Pour le moment, la prolongation de la période de transition s'applique encore : selon la classe de risque, les produits existants peuvent rester sur le marché jusqu’à fin 2027 ou 2028. La pression en matière de conformité vient aussi de la réglementation des produits chimiques : à l'été 2025, l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) a actualisé sa proposition d’interdiction globale des PFAS. Une décision de la Commission européenne est attendue en 2026.
Basée à Neenah dans le Wisconsin (USA), Plexus est une entreprise de services de fabrication et de conception de produits électroniques proposant des solutions complètes de développement, de fabrication et de chaîne d'approvisionnement. C'est ce qu'on appelle une EMS (Electronic Manufacturing Services). Autrement dit, un fabricant sous contrat spécialisé dans l'électronique.
Plexus se concentre sur la production et la fabrication de produits complexes en petites et moyennes séries, intégrés dans des équipements de haute qualité tels que les dispositifs médicaux et les systèmes aérospatiaux.
En Europe, l'entreprise dispose de centres de conception et de sites de production à Livingston au Royaume-Uni et à Oradea en Roumanie.
Pour la Medtech, les besoins d’action augmentent sur deux fronts : les fabricants doivent se préparer à des obligations lourdes d’autorisation et de reporting, tout en examinant des alternatives aux PFAS et en adaptant leurs chaînes d’approvisionnement. Comme en France, la charge réglementaire est considérée comme un frein majeur à la croissance, non seulement en raison de la hausse des coûts, mais aussi parce que des spécialistes hautement qualifiés doivent se consacrer à des tâches de certification. En particulier, les petites et moyennes entreprises – qui représentent tout de même 93 % du secteur allemand de la Medtech – voient leur capacité d’innovation menacée. Pour elles, l’externalisation de certains domaines d’activité gagne encore en importance.
Développement durable : une question de choix de partenaires
Face aux charges bureaucratiques, à la volatilité des marchés et à la hausse des coûts, le développement durable passe parfois au second plan. Mais son urgence n’a en rien diminué. L’UE poursuit sa politique réglementaire de manière conséquente. Ainsi, la Commission a publié à la mi-2025 le plan de travail 2025–2030 pour le règlement sur l’écoconception des produits durables (ESPR). Ce plan de travail aborde des mesures telles que la réparabilité, la recyclabilité ou les achats publics durables, qui pourraient aussi avoir un impact indirect sur les composants Medtech.
Déjà en vigueur, le règlement européen sur les emballages (UE 2025/40) deviendra contraignant à partir d’août 2026. Il impose une recyclabilité accrue et une réduction des matériaux utilisés – explicitement aussi pour les dispositifs médicaux et les diagnostics in vitro. Le potentiel de réduction est considérable : selon la Commission européenne, 84 millions de tonnes de déchets d’emballages ont été générées en Europe en 2021. Pour la Medtech, la marge de manœuvre reste toutefois limitée, les emballages devant avant tout garantir la stérilité, la protection des composants sensibles et des fonctions de barrière.
Pour définir les priorités, les fabricants ont besoin de transparence sur les leviers les plus puissants. La LCA (Life Cycle Assessment) fournit le cadre nécessaire : des analyses tout au long du cycle de vie du produit, des matières premières à la fabrication et au transport, jusqu’à l’utilisation et l’élimination. Cela permet de dégager une vision claire des domaines où les initiatives de durabilité sont les plus efficaces. La mise en pratique passe par des partenaires spécialisés. Ils accompagnent la conception éco-responsable, exploitent des sites de production selon les dernières normes environnementales ou prennent en charge des tâches comme le transport et l’élimination des déchets.
Un potentiel de l’IA encore inexploité
Les fabricants de dispositifs médicaux allemands peinent à intégrer l’IA dans leurs produits. Cette réticence s’explique : réglementation stricte en matière de protection des données, obligations de certification complexes et crainte d’être exposés à des risques réglementaires freinent l’arrivée de produits Medtech de nouvelle génération basée sur l’IA. Mais même dans les processus de production, où les fabricants pourraient bénéficier de contrôles qualité plus rapides, de prédictions de maintenance plus précises et d’une planification des matériaux optimisée, le secteur reste en retrait. Selon une récente enquête de Propel Software, seuls 24 % des fabricants de dispositifs médicaux utilisent l’IA dans l’organisation de la production et du produit. Dans l’industrie high-tech, ce taux atteint 51 %. Ainsi, trois quarts des entreprises Medtech renoncent à des gains d’efficacité déjà réalisés depuis longtemps par d’autres secteurs.
La solution peut venir des partenariats. Les prestataires de fabrication disposant d’une expérience en IA ont déjà rendu leurs installations "IA-ready" et utilisent des processus axés sur les données pour plus d’efficacité et de flexibilité. En externalisant des étapes de production ciblées, les fabricants peuvent amortir le risque réglementaire tout en profitant des technologies les plus récentes – sans devoir mobiliser leurs propres ressources dans un travail de construction long de plusieurs années.
Cybersécurité : la faille des dispositifs connectés
Les dispositifs médicaux sont de moins en moins de simples matériels. En tant que systèmes connectés et pilotés par logiciel, nombre d'entre eux font partie intégrante de l’infrastructure informatique – et constituent donc une cible pour des cyberattaques toujours plus sophistiquées. Selon le Medical Device Cybersecurity Index 2025, 22 % des organisations de santé ont déjà connu des incidents où des dispositifs ont été compromis. Dans 75 % de ces cas, la prise en charge des patients a été directement affectée.
L’UE réagit avec des exigences plus strictes, qui entreront en vigueur l’année prochaine : la directive NIS2, transposée en Allemagne par la loi NIS2UmsuCG, concernera dès 2026 un nombre nettement plus important d’entreprises et imposera des obligations étendues en matière de sécurité et de reporting. Parallèlement, le Cyber Resilience Act (CRA) entamera sa première phase : à partir de septembre 2026, des obligations de notification des incidents de sécurité pour les produits numériques s’appliqueront dans toute l’Europe. Pour les fabricants, il s’agit de relever le défi de sécuriser les dispositifs existants, logiciels anciens et réseaux complexes – sans compromettre l’innovation ni la qualité.
Une issue réside là encore dans les partenariats. Les prestataires de fabrication et de services dotés d’une expertise en cybersécurité ont déjà mis en place des processus et audits assistés par IA. En externalisant certaines tâches, les fabricants peuvent réduire le risque réglementaire et répondre plus rapidement aux exigences de sécurité – sans devoir reconstruire leurs propres infrastructures à partir de zéro.






 X (ex Twitter)
X (ex Twitter) LinkedIn
LinkedIn